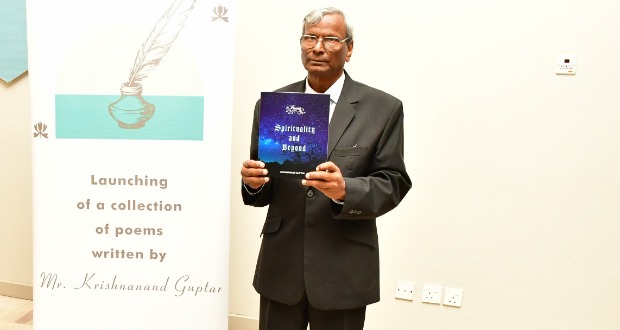Publicité
Salles engorgées: quand les hôpitaux n’arrivent plus à suivre le rythme…
Par
Partager cet article
Salles engorgées: quand les hôpitaux n’arrivent plus à suivre le rythme…

Le Health Statistics Report de 2016 en avait fait état. D’année en année, le nombre de personnes qui se font traiter dans nos hôpitaux ne fait que croître. Idem pour celles nécessitant une admission. Quatre ans après, la situation se dégrade toujours. Les salles d’admission sont engorgées et les patients, eux, se retrouvent admis dans des salles qui ne leur sont pas dédiées initialement. Lorsqu’ils ne sont pas placés dans un coin des couloirs des hôpitaux… Ce constat n’est pas seulement celui des membres du personnel, mais aussi du public qui fréquent ces établissements.
Mercredi après-midi. L’hôpital Jeetoo. À l’heure des visites, tout comme plusieurs parents, ce père de famille a été choqué de constater la présence d’une vieille dame sur le lit à côté de celui de son fils admis en pédiatrie. Pis, cette patiente n’était pas la seule adulte dans cette salle réservée aux enfants. «Les enfants sont très vulnérables. Ils peuvent facilement attraper une maladie contagieuse. Puis, la retraitée en question ne cessait de tousser et elle ne couvrait pas sa bouche. Avec un tissu mouillé, ses proches lui ont donné son bain sur le lit même. Contrairement aux autres salles, dans celle de la pédiatrie, il n’y a pas de séparation entre les lits. Du coup, tout le monde voit tout. C’est traumatisant pour les enfants», affirme Joseph Clair.
Quittons Port-Louis, direction l’hôpital Victoria, à Candos. «Tous les jours, c’est au compte-gouttes qu’on fait les admissions, le plus judicieusement possible. Nos hôpitaux existent depuis quelques décennies déjà. Si le nombre de patients ne cessent d’augmenter, le nombre de salles est, lui, resté le même. Ainsi, si le cas n’est pas sérieux, on donne un traitement et un rendez-vous au patient et il rentre chez lui», indique un médecin. Selon ce dernier, si l’on disposait de moyens pour pouvoir effectuer une échographie ou une radiologie plus rapidement, il n’y aurait pas lieu d’admettre certains patients. Des fois, c’est aussi par manque de médicaments que le médecin est obligé de demander au patient de se faire admettre, afin de le traiter. «Puis, il y a également des protocoles à respecter. Ce sont toutes ces situations qui expliquent que nos hôpitaux soient engorgés. Et c’est un problème qui date de plusieurs années. Les services offerts par les hôpitaux sont très sollicités, et ça coûte cher d’aller en clinique. On doit presser le traitement des uns pour accommoder d’autres cas plus urgents», confie notre source. Sans compter que le transfert temporaire des services de l’hôpital ENT à Candos n’a fait que réduire le nombre de places. Et plus on offre des services, plus le nombre de patients monte en flèche...
Cap sur l’hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle. Sur place, un médecin nous indique que le problème de lit est plus prononcé certains jours comparé à d’autres. «Cela survient surtout le matin. Les patients qui se présentent et nécessitent une admission doivent attendre jusqu’à l’après-midi, soit après le départ d’autres patients. Ils attendent dans la salle de ‘casualty’. Quant à ceux qui ont déjà eu leur décharge, ce n’est que dans l’après-midi que leurs proches viennent les chercher», relate-il. D’ajouter qu’il y a surtout les soins intensifs de cet hôpital qui méritent de l’attention. «On n’a une seule salle générale pouvant accommoder six patients. Or, dans les hôpitaux Victoria et Jeetoo, par exemple, il y a au moins trois ‘Intensive Care Units’», laisse-t-il entendre.
Direction l’Est. À l’hôpital de Flacq, l’on affirme qu’on n’a pas le choix que d’admettre des patients dans d’autres salles car «le taux d’admission ne fait que de croître dans ce petit établissement hospitalier». «Si l’hôpital était doté d’une ‘day care unit’, on aurait pu observer le patient, et ainsi, si son état ne nécessite pas une admission, on aurait pu lui demander de rentrer chez lui», indique-t-on.
Et finalement, dans le Nord, à l’hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam National (SSRN). «Le soir, c’est le fiasco ici. Si l’ambulance arrive tard la nuit avec un patient et s’il n’y a pas de salle disponible, le réflexe des staffs, c’est de bouger un patient relativement âgé dans les couloirs pour avoir de la place pour le nouvel entrant. C’est tellement courant que nous croyons que c’est comme ça qu’il faut procéder normalement», nous confie un Attendant. À une employée affectée aux «medical records» d’enchaîner : «Quand un patient arrive, c’est normal que sa famille va exiger qu’il soit pris en main rapidement voire en priorité. Si elle ne voit pas les choses aller dans son sens, elle va nous insulter. Sauf que, nous, étant sur le terrain, nous savons jauger le niveau d’urgence des patients. Les médias parlent beaucoup des plaintes ou critiques des patients mais il faudrait aussi se dire que le personnel est aussi un être humain. Il n’y a pas de fumée sans feu et cela ne nous fait pas plaisir de travailler dans de telles conditions et de commencer la journée des fois avec «koze kouyon» des patients», souligne-t-elle.
Nous avons contacté un préposé au ministère de la Santé, qui a déclaré qu’il reviendra vers nous demain (NdlR, aujourd’hui).
«Même l’augmentation du nombre de lits ne suffira pas»
Les problèmes dans les hôpitaux ne datent pas d’hier. Et ce ne sont pas les professionnels de la santé qui nous diront le contraire. Sollicité, le Dr Vinesh Sewsurn, président de la Medical Health Officers Association (MHOA) explique que la salle de pédiatrie accueille souvent des adultes car il y a des lits disponibles. Ainsi, certains hôpitaux aménagent une side ward dans la salle de pédiatrie. «Il y a des traitements qu’on ne peut pas donner aux urgences (casualty). Et quand il n’y a pas de place dans les salles, on n’a pas d’autre choix que d’admettre des patients dans d’autres salles. Mais ce n’est pas dans ces autres salles qu’on les admet en premier lieu. Le problème se présente aussi car, lorsqu’un patient obtient sa décharge, il continue à occuper le lit jusqu’à l’arrivée de ses proches dans l’après-midi.»
Quid du transfert des patients dans d’autres hôpitaux ? «Encore faut-il qu’il y ait de la place dans ces hôpitaux. Eux aussi doivent disposer d’un certain nombre de places pour accueillir des patients qui se tournent vers eux», soutient le Dr Vinesh Sewsurn. Bien que cela paraisse simple de proposer la construction d’un nouveau bâtiment ou de quelques étages, tel n’est pas le cas. «Il s’agit d’une policy decision. Car il n’est pas uniquement question d’infrastructure, mais aussi d’équipements et du personnel requis.»
Du côté des médecins spécialistes, l’on affirme que ces arrangements ne dérangent aucunement leur travail. «Cela ne nous prend que du temps à sillonner toutes les salles où les patients ont été admis, surtout dans de grands établissements comme l’hôpital Victoria. Il s’agit d’un problème administratif. Il revient au ministère de la Santé de revoir le système. Ce n’est pas un problème qui peut être résolu du jour au lendemain. Il y a plusieurs choses à voir. Quelquefois, c’est plus facile d’admettre un patient. Leurs proches deviennent agressifs lorsque le médecin donne des médicaments et demande au patient de rentrer chez lui au lieu de le garder à l’hôpital», explique-t-on. Cela dit, «même si on devait augmenter le nombre des lits d’hôpitaux, ce ne sera jamais assez.»
Avis partagé par le Dr Amita Pathack, regional public health superintendent (RPHS) à la retraite. Fort de ses 40 ans de service dans nos hôpitaux, elle confie qu’il y a toujours eu un manque de lits. «Dans les années 70 et 80, deux personnes partageaient un lit étroit. Cette pratique a été bannie en 1999 par feu Kishore Deerpalsingh, ministre de la Santé d’alors. De- puis, il y a une pratique de trouver un lit dans une salle afin que tout patient puisse en avoir un.» Comme d’autres professionnels de santé, le Dr Pathack explique que l’augmentation des admissions découle du fait qu’on soit une population vieillissante, avec un nombre croissant de personnes nécessitant des soins hospitaliers. «À chaque fois qu’une salle est ouverte, elle se remplit immédiatement. Il y a un besoin qui ne peut être satisfait. Sans compter que parfois, cela prend du temps à réaliser certains tests dont on ne peut s’en passer pour des cas sérieux. De plus, le traitement dans le privé coûte cher. Il y a eu des tentatives dans le passé de réguler les tarifs pratiqués dans les cliniques, mais cela n’a pas pu se faire. Et bien qu’elles offrent un meilleur service, la population a plus confiance dans la qualité des soins octroyés par le gouvernement, qui a aussi essayé sérieusement de trouver des solutions à ce problème», souligne le Dr Amita Pathack. Pour sa part, elle propose que les médecins spécialistes épaulent les juniors pour pouvoir ainsi renvoyer les patients chez eux après leur traitement.
À Jeetoo, les problèmes se multiplient
Le trop nuit. C’est la raison pour laquelle le personnel de l’hôpital Jeetoo à Port-Louis se dit révolté par la situation qu’elle subit. Ils sont plusieurs qui n’osent pas élever la voix, de peur de représailles. Mais actuellement, ils étouffent face à ce qu’ils qualifient un manque de considération de la part du ministère. Leur revendication : être reconnu pour leur travail quotidien. «Déjà, l’on ne perçoit plus nos heures supplémentaires comme avant. On comprend que le gouvernement verse l’argent mais depuis que le département des finances a pris feu, les problèmes s’accumulent. L’on nous fait comprendre qu’il faut refaire toutes les demandes et que cela prend du temps.»
Notre source allègue que cela fait plus d’une année qu’elle n’a toujours pas obtenu l’intégralité de ses heures supplémentaires. Elle soutient que l’allocation de Rs 15 000, qui devait être versée à tous ceux ayant travaillé sans relâche durant la période de confinement, n’a toujours pas été reçue pour tout le personnel. Mais ce qui décourage le plus le personnel, c’est le nombre d’absences recensés ces derniers temps. «Les gens sont tellement découragés qu’ils ne viennent pas travailler. Dans une salle, le minimum d’infirmiers est de trois. Mais il y a des soirées où l’on se retrouve uniquement à deux. Vous imaginez que cette semaine, la salle où l’on place les femmes avant l’accouchement n’avait que deux membres du personnel en soirée. Heureusement qu’il n’y a pas eu d’incident. Mais vous pensez qu’il y a au minimum 25 femmes prêtes à accoucher dans cette salle.» Autre souci rencontré, c’est le manque d’équipements adéquats. Un autre membre du personnel s’est lui plaint d’être encore en salle de radiologie. «Plus de cinq ans à s’activer dans cette salle. On ne trouve pas de nouveau personnel à former pour prendre la relève mais entre-temps, ma vie est en jeu. Surtout avec les doses de radiation.»
À Souillac : requête pour une ambulance du SAMU
Le personnel de Souillac soutient qu’hormis le manque d’équipements pour les pansements à faire au quotidien, le véritable problème réside dans le fait qu’il n’y ait pas d’ambulance permanente du SAMU dans l’enceinte de l’hôpital. «Il n’y a que deux vieilles ambulances. On a une ambulance du SAMU qui opère de 9 heures à 16 heures. Mais le mieux serait d’en avoir une en permanence.» Pour ce personnel, ceux qui habitent loin de Souillac rencontrent souvent ce problème en cas d’urgence. Autre fait reproché est l’absence d’une Flu Clinic dans la région. Il suggère qu’il aurait fallu plusieurs entrées pour éviter tout risque de contagion.
Publicité
Les plus récents