Publicité
Jean Ramiah: «Le relâchement dans la police est au quotidien»
Par
Partager cet article
Jean Ramiah: «Le relâchement dans la police est au quotidien»
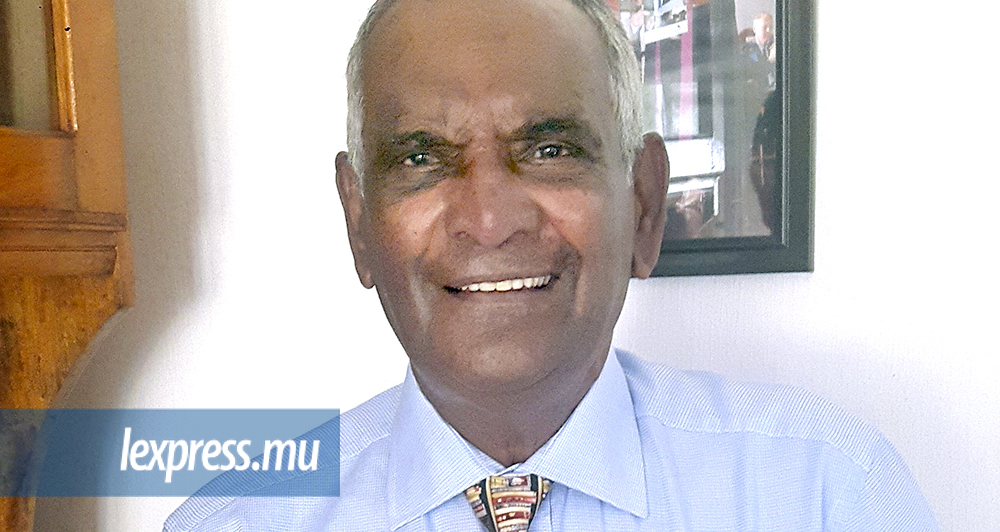
Il y a 40 ans, juste après l’incendie du journal «Le mauricien», Jean-Paul Sheik Hossen accusait quatre membres de la Special Branch de crime d’incendie. Jean Ramiah, le seul survivant de ces allégations, qui se sont révélées infondées, revient sur cette affaire et jette un regard critique sur la police.
Comment avez-vous intégré la Special Branch (SB), rebaptisée State Security Service et connue désormais comme le National Security Service (NSS) ?
Par hasard. Sans doute parce que l’on avait vu que j’étais un homme de terrain. Je suis rentré à la police le 3 janvier 1967. J’avais 23 ans. J’ai été affecté à plusieurs postes et j’ai aussi fait trois ans à la Special Mobile Force. Un jour, on m’a informé que j’ai été sélectionné pour travailler au sein de la SB, dirigée par l’ancien commissaire de police Rajmohunsing Fulena.
Quelle était la nature de votre travail ?
Je devais fournir des informations ayant trait à la sécurité au Security Advisor John Rewcastle, à M. Fulena, qui avait pour assistant le surintendant Sénèque. À l’époque, les travailleurs étaient en ébullition et il fallait informer le gouvernement des mouvements de protestation et des menaces de grève. J’étais basé à Vacoas-Phoenix et il y avait bon nombre d’industries comme la compagnie Vacoas Transport, les sucreries de Réunion et de Highlands et d’autres entreprises. Pour y arriver, il fallait tisser un réseau d’informateurs dans chaque secteur, faire jouer ses contacts et s’appuyer sur les amis. Pour être bien informé, la constitution de ce réseau est primordiale.
Surveiller les politiciens, était-il dans vos attributions ?
Oui, car il y avait l’état d’urgence. Il fallait avoir l’oeil sur eux et assister aux meetings. Je n’oublierai jamais la venue de la reine Elisabeth en 1972. Il fallait être extrêmement vigilant pour que cette visite ne soit pas perturbée. Cela supposait une présence quasiconstante sur le terrain. Il n’y a eu aucun trouble, fort heureusement. Et après, le travail a repris normalement.
Comment vous êtes-vous retrouvé impliqué dans l’affaire Sheik Hossen ?
Plusieurs mois avant l’incendie au journal Le mauricien le 11 juin 1978, le surintendant Sénèque m’a pris à part pour me dire qu’un certain Jean-Paul Sheik Hossen, qui se disait journaliste au Cernéen, et qui habitait Vacoas, avait des renseignements sensibles à communiquer. J’ai eu comme instruction d’aller le voir chez lui et de l’écouter. Il louait une chambre dans une petite maison délabrée à la route John Kennedy. Il passait pour un fin intellectuel, qui disait avoir travaillé dans d’importants titres de presse en Belgique et à l’étranger. Je l’ai rencontré. Il s’exprimait dans un français impeccable. Il disait qu’un complot se fomentait. Des mercenaires allaient débarquer pour faire un coup d’État.
Ces informations qu’il essayait de me faire avaler n’étaient pas crédibles, dans la mesure où il n’arrivait pas à me fournir des noms, des dates et d’autres renseignements précis. J’ai dû le rencontrer à deux ou trois reprises et à chaque fois, les informations étaient imprécises. Si bien que lorsque j’ai fait mon rapport au surintendant Sénèque, je lui ai dit que Jean-Paul Sheik Hossen était un fabulateur. Mais comme le journaliste insistait auprès de la SB, j’ai refusé de le revoir et j’ai demandé à mon inspecteur Jean-Paul Venkatachellum de traiter avec lui. Le service a fini par l’ignorer.
Le 11 juin 1978, il y a l’incendie du Mauricien. Dès le lendemain, le journal Le Militant publie en gros titre que Jean-Paul Sheik Hossen affirmait que le directeur Fulena, son adjoint Sénèque, Jean-Paul Venkatachellum et moi avions comploté pour mettre le feu. C’était une campagne contre la S B. Nous étions choqués. Le gardien Yves Bedos a confirmé la version de Sheik Hossen.
L’affaire a duré quelques mois, jusqu’à l’institution de la commission d’enquête présidée par le magistrat Hossen. En attendant d’être convoqué pour déposer, je continuais le travail. Alors que je prenais des notes sur ma moto lors d’un meeting du Mouvement militant mauricien (MMM) à la place de taxi à Phoenix, les orateurs ont repris les allégations de Jean-Paul Sheik Hossen. Amédée Darga m’a vu. Il m’a pointé du doigt en disant : «Le voilà !» Des membres du public ont commencé à me regarder bizarrement. Certains ont marché dans ma direction. Sentant que j’allais finir lynché, j’ai filé.
Quand j’ai remis mon rapport, la police a vu que le député avait violé un article de la Public Order Act. Le Directeur des poursuites publiques a instruit un procès. Devant le juge De Ravel, j’ai témoigné. Amédée Darga était défendu par les avocats ténors du MMM d’alors qu’étaient sir Anerood Jugnauth et feu Khader Bhayat. L’avocat du Parquet était Vinod Boolell. Malgré le feu roulant de questions des deux avocats de Darga, qui ont essayé de me confondre, j’ai maintenu ma version. Quand le juge s’est retiré pour délibérer, sir Anerood Jugnauth s’est tourné vers Darga et lui a dit : «Trois mois piti.» Il a effectivement écopé de trois mois de prison. J’étais content. Les années passant , Amédée Darga et moi sommes devenus amis, c’est sans rancune. J ’aides rapports amicaux avec les politiciens de tous bords que j’ai côtoyés durant ma carrière. Mon travail était d’avoir des renseignements. Je le faisais sans préférence pour aucun parti.
Avez-vous déposé durant la commission d’enquête sur les allégations de Sheik Hossen ?
Je n’ai pas eu à le faire. La commission a réalisé assez vite que ses allégations étaient fabriquées de toutes pièces et que ce n’était pas une personne fiable. Il avait émis un chèque sans provision et il a fait de la prison pendant un an. Il paraît qu’il était un des meneurs de la révolte à la prison de Beau-Bassin en 1979. À sa libération, il est reparti en Belgique.
Avec recul, pourquoi a-t-il agi ainsi ? Était-il téléguidé ?
Non, je ne le crois pas. C’était un électron libre, un peu psychopathe sur les bords. Malheureusement, les journalistes du Militant sont tombés dans son panneau.
D’autres faits saillants durant votre carrière ?
En 1993, j’ai été nommé chef inspecteur et responsable des basses Plaines-Wilhems et de Rivière-Noire. J’avais sous ma responsabilité une quinzaine d’hommes. J’ai assisté au meeting sur la dépénalisation du gandia, organisé par l’avocat Rama Valayden, en février 1999. La police régulière a fait son enquête et soumis des noms des fumeurs de gandia. J’ai aussi fait mon rapport. Il y a eu pas mal d’arrestations, dont celle du chanteur Kaya, avec les conséquences tragiques que l’on sait. J’ai déposé devant la commission d’enquête sur ce meeting, présidée par le juge Matadeen.
Culpabilisez-vous par rapport aux événements tragiques qui ont suivi ?
Non, car je n’avais fait que mon travail de policier de terrain, rétribué par l’État. Pour être performant dans le service, il faut donner du temps. Ce n’est pas du jour au lendemain que l’on forme un agent de renseignements. La même chose s’applique aux policiers de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) et à ceux de la Criminal Investigation Division (CID). Pour avoir des renseignements et infiltrer les réseaux de drogue, il faut être sur le terrain. C’est un travail minutieux, qui prend du temps. Pareil pour la CID. Pour que ses membres reconnaissent les récidivistes et les autres bad characters, il faut qu’ils soient sur le terrain et constituent leurs réseaux d’informateurs.
En tant qu’enquêteur de terrain, qui a fait presque 30 ans dans les renseignements et qui s’est retiré en 2003 en tant qu’assistant surintendant de police (ASP), je dis qu’il ne faut pas démanteler l’ADSU. Le Premier ministre a raison. Il n’y a aucune nécessité pour cela. Il faut juste y enlever les brebis galeuses mais pas démanteler l’ADSU et la remplacer par une autre structure avec des recrues. Cela ne marchera pas.
Bon nombre de policiers n’ont pas fait honneur à la force ces derniers temps. Où le bât blesse-t-il ?
Cela ne vient pas des qualifications, qui ont été rehaussées. De mon temps, sur 100 recrues, sept seulement avaient réussi l’examen de Form V. Il faut revoir le recrutement. Lorsque l’on recrute n’importe qui, le fils ou le cousin d’untel, c’est normal qu’il y ait des brebis galeuses. Il faut aussi plus de jugement lors de la première visite d’un aspirant policier aux Casernes centrales. On ne peut pas accepter que celui-ci se présente avec une barbe de plusieurs jours, les cheveux longs, débraillé. Ensuite, il faut renforcer la discipline à 100 % lors de la formation et faire de la supervision au poste et en dehors, comme cela se faisait autrefois, tous les trois mois, jusqu’à la confirmation de la recrue au bout de deux ans. Un report de la confirmation équivalait au non-paiement d’un increment.
Ce relâchement dans la police est au quotidien. Allez près d’une banque et regardez les policiers. Souvent, ils parlent sur leur portable ou ont leurs écouteurs et sont sans chapeau. Certains sont même appuyés à un mur comme si cette structure allait s’effondrer. C’est inconcevable car cela donne un mauvais signal au public.
Il faut mettre la NSS à contribution. Autrefois, les membres de cette unité faisaient le screening des aspirants policiers et rédigeaient un rapport sur chacun. Cela faisait partie du travail des supérieurs de chaque district d’avoir un oeil sur le travail de leurs subordonnés. Cette pratique est-elle toujours en cours ? À deux reprises, j’ai dû me rendre au poste de police de Curepipe et à celui de Quatre-Bornes. Les policiers que j’y ai croisés m’ont familièrement appelé «Ton». Depuis quand on traite les gens ainsi ? Il faut être plus ferme et plus exigeant envers les policiers. Je suis triste et inquiet quand je vois ce relâchement et cette détérioration.






